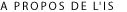Comités de l'IS
Afrique
Dakar
19-20 juin 2009
Images (18)
Contenu de l'Article
- Dakar, 19-20 Juin 2009
- Déclaration de Dakar
- List des Participants
- Discours par Ousmane Tanor Dieng, Secrétaire général du Parti Socialiste du Sénégal
- Discours par le Secrétaire général de l'IS Luis Ayala
- Présentation par Serigne Mbaye Thiam, Secrétaire national pour Élections et Affaires Juridiques du Parti Socialiste du Sénégal
- Présentation par Mamadou Faye, Secrétaire National aux Questions Économiques et à la Bonne Gouvernance du Parti Socialiste du Sénégal
- Présentation par Khalifa Ababacar Sall, Secrétaire national pour la Vie Politique du Parti Socialiste du Sénégal
- Activités apparentées
Afrique
D’un temps de crise à une nouvelle ère de partenariat inclusif : le Comité de l’IS s’est réuni à Dakar
19-20 juin 2009
I. D’abord, les concepts
La gouvernance, notion anglo-saxonne venue du monde des entreprises, est devenue un vocable à la mode qui, à force de déclinaisons aussi diverses les unes que les autres, ne peut être élevé au rang de concept, tant son extension en a accru l’imprécision. Ce caractère imprécis est tel qu’on lui adjoint systématiquement une épithète qui lui confère la qualité qu’elle devrait remplir.
C’est ainsi que, associée à la démocratie, la gouvernance interroge la légitimité des modes de régulation publique et du fonctionnement des institutions, qu’il s’agisse de la régulation ou des institutions nationales comme internationales. Le qualificatif « démocratique » insuffle donc à la gouvernance une dimension politique.
II. De vieilles institutions et de vieilles régulations dans un monde en mutation
Le traumatisme causé par les deux guerres mondiales a fait prendre conscience de la nécessité pour l’humanité de faire évoluer les valeurs fondatrices, les relations ainsi que l’organisation de la société internationale.
La création des institutions de Bretton Woods et de l’ONU et l’adoption de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, répondaient à un triple enjeu : préserver la paix mondiale, définir des valeurs communes de l’humanité, reconstruire l’économie des États ayant subi les conséquences de la guerre et stabiliser les grandes monnaies.
Depuis près de 60 ans, les institutions internationales ont certes beaucoup évolué, mais pas au même rythme que le Monde. Les agences spécialisées se sont multipliées ; l’ONU a vu le nombre d’États membres augmenter considérablement. Pendant ce temps, le monde a lui-même changé avec la montée de nouveaux défis, environnementaux, technologiques, sécuritaires, économiques et sociaux. Les rapports internationaux marqués par l’opposition Est-Ouest ont changé avec la chute du Mur de Berlin. Les États ne sont plus que des acteurs parmi d’autres de la communauté internationale : la multiplication des agences spécialisées a accru le pouvoir des experts ; la globalisation a permis le débordement des pouvoirs étatiques par les pouvoirs économiques et financiers, notamment les grandes multinationales ; les défis environnementaux et sociaux ont fait naître un embryon de société civile internationale dont la capacité d’influence est de plus en plus déterminante.
Pourtant, face à des mutations de grande ampleur, les institutions et les régulations mondiales n’ont pas changé à la mesure des nouveaux défis. Les relations internationales demeurent encadrées par « l’ordre Wesphalien », qui n’envisage ces relations que sous le prisme des États et sur le fondement des principes de souveraineté et d’égalité.
Dans le même temps, la souveraineté des États s’avère de plus en plus obsolète au regard des interdépendances économiques, sociales, politiques et environnementales et de la nouvelle philosophie du droit d’ingérence. Le principe d’égalité des États devient sujet de préoccupation lorsque les instances de décision regroupant les pays les plus riches, à l’instar du G8 ou du G20, sont devenues les principaux lieux de détermination de la politique mondiale et lorsque les différences de puissance nourrissent les différences de traitement entre les États. La diplomatie exclusivement étatique ne rend plus compte de la multiplicité et de la complexité des acteurs internationaux dont la puissance dépasse souvent celle des États.
Le paradigme d’une communauté internationale constituée par des États dont les rapports s’ordonnent autour de leur souveraineté et de leur égalité, n’a pas évolué aussi bien au plan des institutions qui se sont multipliées sans se réformer qu’au plan des règles qui sont restées quasiment les mêmes.
Le décalage entre les institutions et les règles d’un côté et les réalités du monde de l’autre, constitue la source de ce que l’on peut appeler une véritable crise de la gouvernance mondiale. Les défis contemporains et futurs sont regardés avec les lunettes d’hier ; le XXIème siècle est pensé et régi avec des institutions et des règles du siècle dernier, institutions elles-mêmes fondées sur une philosophie du XVIIème siècle. Les fondements philosophiques et idéologiques de l’action collective n’ont pas connu un renouvellement substantiel.
Or, la question est précisément de savoir si l’on peut continuer à fonder les relations internationales sur le principe de souveraineté des États ; et si l’égalité décrétée entre les États (« Un État, une voix », dit-on au sein des institutions internationales) a encore un sens. Peut-on réglementer les rapports internationaux sans tenir compte de la diversification et de complexification de leurs acteurs, de leurs enjeux, et de la singularité des processus politiques?
La réponse à ces questions est sans équivoque. Nous ne pouvons plus gérer un monde nouveau avec de vieilles institutions, de vieux systèmes de pensée.
Mais, quelles nouvelles institutions et quelles nouvelles régulations devrions-nous inventer ? Comment garantir l’efficacité, la légitimité et le caractère démocratique de ces institutions et mettre en œuvre des régulations acceptées, reconnues et respectées par tous les acteurs de la société internationale ? Quels devraient être les nouveaux fondements éthiques et philosophiques des relations internationales ?
L’Afrique, plus que tout autre continent, doit être au cœur de ces problématiques et des réponses qui doivent leur être apportées. Elle est l’une des parties du monde qui subit, avec la plus grande impuissance, les violences des mutations du monde. Elle reste le continent le plus marginalisé au plan économique et politique alors qu’elle vit les conséquences les plus dramatiques de la mondialisation. Elle est donc sans doute le continent qui a le plus intérêt à la définition d’un nouveau paradigme, de nouveaux modèles, autour desquels doivent s’ordonner les relations internationales. En raison de sa marginalisation et de son faible poids dans la définition des grands agendas et dans les décisions qui déterminent l’avenir de la planète, l’Afrique doit surtout relever le défi de la construction d’une nouvelle démocratie mondiale dans laquelle elle aurait une voix et une place digne de sa contribution à l’histoire de l’humanité.
L’évidence d’un tel défi cache pourtant mal la complexité de la tâche. L’Afrique doit d’abord définir sa propre vision des rapports internationaux et particulièrement de la démocratie mondiale, en tenant compte de ses propres spécificités et du nouveau contexte mondial. L’analyse de ce nouveau contexte et des défis du monde fournit à la fois les prémices et les prémisses de la nouvelle gouvernance démocratique mondiale.
III. Les prémices d’une nouvelle gouvernance démocratique mondiale : les signes précurseurs d’une refondation
Trois facteurs décisifs sont en train de constituer les bases de nouvelles régulations mondiales.
Le premier facteur est lié à l’idée selon laquelle le processus de mondialisation ne saurait se réduire à la globalisation économique. Les instances socialistes nationales et internationales de même que certains milieux altermondialistes dénoncent, depuis longtemps, les risques d’impasse et de crise économique et sociale auxquelles conduisent inéluctablement les théories ultralibérales.
La crise actuelle et celle de la fin des années 90 ont vu se concrétiser les dangers de la globalisation économique néolibérale. Les tentatives politiques actuelles des États les plus riches pour trouver de nouvelles règles aptes à encadrer les activités économiques et financières mondiales constituent la preuve d’une prise de conscience de la nécessité de ne plus appréhender les rapports internationaux sous le seul prisme du tout économique et, partant, du marché. Le renversement du paradigme est évident : il faut remettre l’économique dans le giron du politique et au service de l’Humanité. Ce renversement constitue donc une opportunité historique de refondation des régulations mondiales.
Le deuxième signe annonciateur d’une refondation est l’impuissance des États les plus forts à relever seuls certains défis comme les risques terroristes, la prolifération nucléaire ou la protection de l’environnement. Ces défis ont révélé que certains problèmes globaux ne peuvent être approchés sur le modèle de la compétition et de la domination et que les interdépendances sont telles que les États les plus puissants sont souvent contraints de compter avec les États les plus faibles. Le renversement d’un deuxième paradigme s’opère sous ce rapport : les relations internationales doivent davantage être régulées par le multilatéralisme que par l’unilatéralisme ; et que le multilatéralisme ne doit pas se limiter à un dialogue entre les pays les plus puissants. De fait, le renouveau et l’élargissement du multilatéralisme sont imposés par la place croissante des nouveaux puissants sur la scène mondiale, à l’image du Japon, de la Chine ou encore de l’inde ou du Brésil. C’est tout le sens du passage du G8 au G20.
Le troisième signe qui constitue une formidable opportunité de refondation des institutions et des règles de la gouvernance mondiale réside dans le développement considérable des espaces mondiaux de débat sur les problèmes de la planète. C’est qu’à l’échelle mondiale, des rudiments de démocratie directe et trans-étatique révèlent que les États et les multinationales ne sont pas les seuls acteurs capables d’influer sur les relations internationales. Sous ce rapport, un troisième paradigme est renversé : la démocratie mondiale ne peut plus exclusivement s’ordonner autour de la représentation des États souverains au niveau international ; la démocratie représentative internationale doit être conciliée avec « une démocratie des peuples ». L’ONU et la Banque mondiale s’y essaient.
Le renversement de ces trois paradigmes est d’une importance capitale pour l’Afrique. Économiquement et politiquement faible, marginalisée mais perméable aux chocs mondiaux, sa voix trouverait davantage à s’affirmer dans une reprise en main des affaires mondiales par le politique, dans la régulation multilatérale et dans la consolidation d’une véritable communauté mondiale dépassant la juxtaposition d’intérêts nationaux exclusivement étatiques.
Il reste à déterminer les prémisses de la nouvelle gouvernance démocratique mondiale impliquant l’Afrique en s’appuyant sur ces facteurs d’évolution de la société internationale.
IV. Les prémisses d’une nouvelle gouvernance démocratique mondiale impliquant l’Afrique
L’instauration d’une nouvelle gouvernance démocratique au niveau mondial suppose que les piliers qui en constituent les fondements soient clairement identifiés.
1er pilier : Pour impliquer l’Afrique, la nouvelle gouvernance démocratique mondiale doit être fondée sur une représentation régionale dans les institutions internationales
La multiplication des États indépendants, donc souverains, rend évident un fait majeur : on ne peut plus continuer à considérer la communauté internationale comme la juxtaposition directe des intérêts nationaux. Outre les difficultés à bâtir les consensus sur les questions d’intérêt mondial, les petits États y trouvent rarement leur compte, soumis qu’ils sont à la loi des plus puissants. Pour sortir des impasses inhérentes à la représentation par les États, ne faut-il pas envisager un changement d’échelle de représentation des intérêts sur le plan mondial ? Un niveau intermédiaire entre les États et le monde ne devrait-il pas être construit ? Ce niveau ne pourrait-il pas être constitué par les communautés régionales ? Sans être totalement constituées, ces communautés régionales sont préfigurées par des entités qui existent déjà sur la scène mondiale : Union européenne, Union Africaine, etc. Si l’on est convaincu que les processus d’intégration régionale sont une des réponses les plus adéquates à la mondialisation, pourquoi douterait-on que les intérêts de l’Afrique puissent être défendus au plan international par les institutions d’intégration régionale ?
Un exemple simple permet d’illustrer l’utilité d’une telle proposition : la représentation au sein du Conseil de sécurité des Nations-Unies. Tout le monde s’accorde à reconnaître que les règles de sa composition ne sont plus conformes à l’état actuel du monde et à l’évolution des rapports de force économiques, politiques et militaires. Tout le monde lui reproche de ne pas satisfaire aux exigences de la démocratie puisque tout le monde n’y est pas représenté. Pourtant, la solution souvent préconisée pour répondre à ces critiques, relique de l’ordre westphalien, est simplement d’admettre son élargissement à de nouveaux États, comme si la démocratie mondiale pouvait se satisfaire d’une sorte de droit fondée sur la puissance, comme si on avait oublié que le choix de ces nouveaux membres ne peut être qu’une occasion de nouvelles confrontations entre États dits souverains et dont le titre à décider à la place des autres sur des questions mondiales ne pourra jamais être justifié de façon irréfutable. En Afrique, dès lors que la question est posée, s’affrontent plusieurs critères de choix : légitimité diplomatique, poids démographique, puissance économique. Posée dans ces termes, la problématique de la démocratisation du Conseil de sécurité se heurte à un écueil qui s’avère insurmontable, aussi bien pour l’Afrique que pour le reste du monde.
En revanche, dès lors que nous admettons l’idée que la représentation des États peut être déléguée à des instances supranationales, plus précisément régionales, la solution devient plus simple. Il faut d’ailleurs remarquer que de tels mécanismes de représentation existent déjà. La plupart des États africains ont consenti de véritables transferts de souveraineté au profit d’instances supranationales, que ce soit pour les négociations commerciales internationales, les politiques monétaires ou fiscales (exemple de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine) ou pour la réglementation de certains domaines (exemple de l’Organisation pour l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique ou de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances). C’est dire donc que les deux conditions pour que l’Afrique puisse parler d’une seule voix dans de nouvelles institutions mondiales démocratiques sont remplies : l’instance de représentation d’une part, à savoir la communauté régionale, et d’autre part, le mécanisme de représentation, à savoir la délégation de souveraineté.
2ème pilier : Pour impliquer l’Afrique, la nouvelle gouvernance démocratique mondiale doit être fondée sur de nouveaux mécanismes de détermination du « Bien commun »
Au-delà de la question de la forme de représentation favorable à l’Afrique, les fondements organisationnels d’une gouvernance démocratique mondiale concernent les mécanismes de détermination de ce qui constitue l’intérêt général au niveau mondial. Dans la pratique, la combinaison de deux éléments nous semble essentielle pour l’Afrique : la maîtrise des agendas internationaux et les mécanismes de prise de décision.
En effet, la fixation des agendas internationaux permet de déterminer les questions qui sont censées représenter des priorités pour la communauté internationale. Or, ce qui importe de ce point de vue, c’est souvent moins l’objet des questions étudiées que ceux qui décident de les élever au rang de questions représentatives de l’intérêt commun de l’Humanité. Les agendas internationaux sont ainsi soumis à la bonne volonté des pays riches qui les définissent en fonction de leurs propres priorités et, le plus souvent, en dehors des instances où les pays africains sont présents.
La gouvernance mondiale peut-elle être qualifiée de démocratique si justement elle n’est pas en mesure de garantir la prise en considération de questions jugées essentielles pour l’ensemble de la communauté internationale ? La récente crise alimentaire nous en fournit la preuve. Alors que la FAO avait appuyé sur la sonnette d’alarme bien avant ses premières manifestations, elle n’a pas été considérée comme un point prioritaire de l’agenda de la communauté internationale tant son impact n’intéressait principalement que les pays pauvres. Les négociations internationales sur les questions environnementales en constituent une autre preuve. L’attitude des Etats-Unis, défendant à tout prix, le mode de vie des américains a paralysé pendant plusieurs années la portée de toute négociation dans ce domaine dès lors qu’était censé être menacé un intérêt que seule une minorité d’États considère comme vital.
En ce qui concerne les mécanismes de prise de décision au niveau mondial, l’exemple du droit de véto est si connu qu’il n’est pas nécessaire d’y insister. Il pose simplement une question de fond, qui n’est pas totalement éloignée de la précédente : les affaires de l’humanité peuvent-elles continuer à dépendre de la volonté d’un seul État qui, par son droit de véto, pourrait paralyser toute avancée sur des défis cruciaux pour le monde ? Ce droit de véto est-il toujours compatible avec l’idée d’une gouvernance démocratique mondiale ? S’il devait être maintenu, son attribution ne devrait-il pas répondre à de nouveaux critères ? La réflexion peut être élargie, sous ce rapport, à la pertinence de tous les mécanismes de prise de décision au sein de l’ONU. Peut-elle par exemple continuer à fonctionner sur la base des mêmes règles que lors de sa constitution ? Une institution créée pour une quarantaine de membres ne doit-elle pas envisager de modifier ses mécanismes de fonctionnement lorsqu’elle regroupe désormais plus de deux cents membres ? On devine aisément que toutes ces questions intéressent au plus haut point le continent africain car les réformes qu’elles appellent conditionnent grandement la place et le rôle qu’il doit jouer dans les instances mondiales.
3ème pilier : Pour impliquer l’Afrique, une gouvernance démocratique mondiale doit repenser ses fondements éthiques et philosophiques
Égalité et souveraineté des États sont, rappelons-le, les deux principes fondamentaux des relations internationales.
A l’épreuve, nul ne peut contester que ces principes sont devenus des fictions très éloignées de la réalité. Égalité et souveraineté sont caractérisées par le primat de l’individuel et par leur rigidité théorique et pratique.
Or, la gouvernance mondiale ne saurait se réclamer de la démocratie que si elle alliait intérêt individuel et défis mondiaux. L’Afrique n’a elle-même tiré aucun intérêt de ces principes. Peut-elle continuer à se réclamer du principe d’égalité lorsque, par exemple, des pays qui subventionnent leur agriculture exigent la libéralisation totale du commerce des produits agricoles ou que des institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, chargées à l’origine du financement de la reconstruction des grands pays et de la stabilisation des grandes monnaies, sont devenues des instruments d’action des pays riches sur les pays pauvres ? L’Afrique, peut-elle encore invoquer le principe de souveraineté lorsque, par exemple, les plus petites multinationales occidentales sont capables de déstabiliser toute une région en y provoquant et en y alimentant les conflits armés ?
C’est dire que les fondements éthiques de la gouvernance mondiale doivent évoluer.
Osons à cet égard deux substitutions, provocatrices certes mais riches en perspectives.
La première consisterait à affirmer la primauté de l’équité sur l’égalité. L’appliquer aux relations commerciales ne permettrait-elle pas de sortir des méfaits de la libéralisation outrancière en considérant que tous les États et tous les acteurs ne sont pas placés dans les mêmes conditions pour affronter une concurrence mondiale sans limite ? En matière de protection de l’environnement, les pays africains peuvent-ils être traités de la même manière que les pays riches alors que leur état de sous-développement leur fait subir des contraintes spécifiques ? Les politiques d’immigration choisies fondées sur le contrôle des flux de personnes sont-elles équitables ? Analysées sous le rapport de l’équité et non de l’égalité, il va de soi que la manière d’appréhender ces problématiques change radicalement les perspectives.
Ensuite, ne faudrait-il pas affirmer le primat de la responsabilité sur la souveraineté. Le droit d’ingérence en est une application ; le Tribunal pénal international en est un des instruments de mise en œuvre. Les interdépendances actuelles, la promotion et la défense de valeurs communes ne justifient-elles pas un tel renversement de l’ordre des principes ?
4ème pilier : Pour être impliquée dans la nouvelle gouvernance démocratique mondiale, l’Afrique doit s’efforcer d’être un modèle de démocratie
Ce pilier est le facteur propre à l’Afrique. Les trois premiers se construisent avec le reste du monde, mais ce quatrième pilier conditionne la légitimité de l’exigence d’une nouvelle gouvernance démocratique mondiale par l’Afrique. Autrement, la légitimité du demandeur renforce la légitimité de la demande.
Alors que d’autres États comme la Chine ou l’Inde pourraient fonder cette exigence sur des considérations économiques, démographiques ou militaires, l’Afrique, elle, peut essentiellement valoriser d’éventuels atouts politiques.
Or, sous ce rapport, la situation du continent est très hétérogène, mais globalement inquiétante du fait de la conjonction de deux facteurs qui ont tendance à se généraliser. C’est, d’une part, la remise en cause, souvent unilatérale, des symboles les plus significatifs des consensus issus des vagues de démocratisation des années 90, notamment la limitation constitutionnelle de la durée et du nombre des mandats des présidents de la République. C’est, d’autre part, la pollution des vies politiques nationales par les familles des chefs d’État qui tiennent à « arranger » leur succession. Or, sans pour autant méconnaitre la dialectique du jeu des forces intérieures et extérieures au continent, on pourrait légitimement se poser la question de savoir si l’Afrique, serait fondée à réclamer une gouvernance démocratique mondiale si elle est incapable de respecter les principes démocratiques les plus élémentaires auxquels elle déclare s’astreindre ?
Activités apparentées
-
Réunion du Comité Afrique de l'IS, Luanda, Angola
12-13 décembre 2017
-
L’Afrique au coeur de l'IS à Accra, Ghana
07-08 octobre 2016
-
Réunion du Comité Afrique de l'IS, Bamako, Mali
10-11 avril 2015
-
Réunion du Comité Afrique de l’IS, Dar es Salaam, Tanzanie
28-29 mars 2014
-
Soutenir la paix, la démocratie et la solidarité au Sahel
17-18 mars 2013
-
Le Comité Afrique de l'IS se réunit à Praia
30-31 juillet 2012
-
Réunion du Comité à Windhoek, Namibie
29-30 juillet 2011
-
Le Comité Afrique de l'IS se réunit à Abidjan
14-15 juin 2008
-
Réunion à Buenos Aires du Comité économique de l’IS
09 novembre 2007
-
Le Comité de l’IS sur l’Economie, la Cohésion sociale et l’Environnement se concentre sur les économies en transition
09-10 septembre 2007
-
Réunion du Comité Afrique de l'IS à GHANA
15-16 juin 2007
-
Réunion du Comité Afrique de l’IS, Praia, Cap-Vert
20-21 octobre 2006
-
PRIORITES DES SOCIALISTES en Afrique à la réunion de l’IS au Niger
24-25 avril 2006
-
L’Internationale Socialiste réaffirme sa solidarité avec l’Afrique au FORUM SOCIAL MONDIAL à Bamako, Mali
21 janvier 2006
-
L’InternationaleSocialiste se réunit à Hong Kong la veille de la Conférence de l’OMC
12 décembre 2005
-
Le Comité économique de l’IS s’est réuni sur le continent africain à lOFFICE DE L'ONU A NAIROBI
08-09 avril 2005
-
La réunion du Comité Afrique de l’IS s’est tenue à Dakar
12-13 juillet 2004
-
Réunion au Bénin du Comité Afrique de l’Internationale Socialiste
15-16 septembre 2003
-
Mission de l’Internationale Socialiste dans la Région des Grands Lacs
18-23 février 2003
-
La réunion de l’Internationale Socialiste en Côte d’Ivoire soutient le cessez-le-feu, l’ordre constitutionnel et la démocratie
18 octobre 2002
-
Première réunion de l’IS en Angola
26-27 juillet 2002
-
Réunion du Comité Afrique de l'IS, Niamey, Niger
01-02 juin 2001
-
Réunion du Groupe de Travail de l'Internationale Socialiste sur l'Organisation Mondiale du Commerce, Maputo, Mozambique
11 novembre 2000
-
Réunion du Comité Afrique de l’Internationale Socialiste, Praia, Cap-Vert
30-31 octobre 2000
-
Réunion du Comité Afrique de l’Internationale Socialiste, Yaoundé, Cameroun
30 juin-01 juillet 2000
-
Réunion du Comité Afrique de l'Internationale Socialiste, Maputo
03-04 septembre 1999
-
Réunion du Comité Afrique de l'Internationale Socialiste, Bamako, Mali
29-30 mars 1999
-
Réunion du Comité Afrique de l'Internationale Socialiste, Dakar, Sénégal
25-26 juillet 1997
Si vous recherchez une réunion antérieure, veuillez consulter la section BIBLIOTHEQUE.